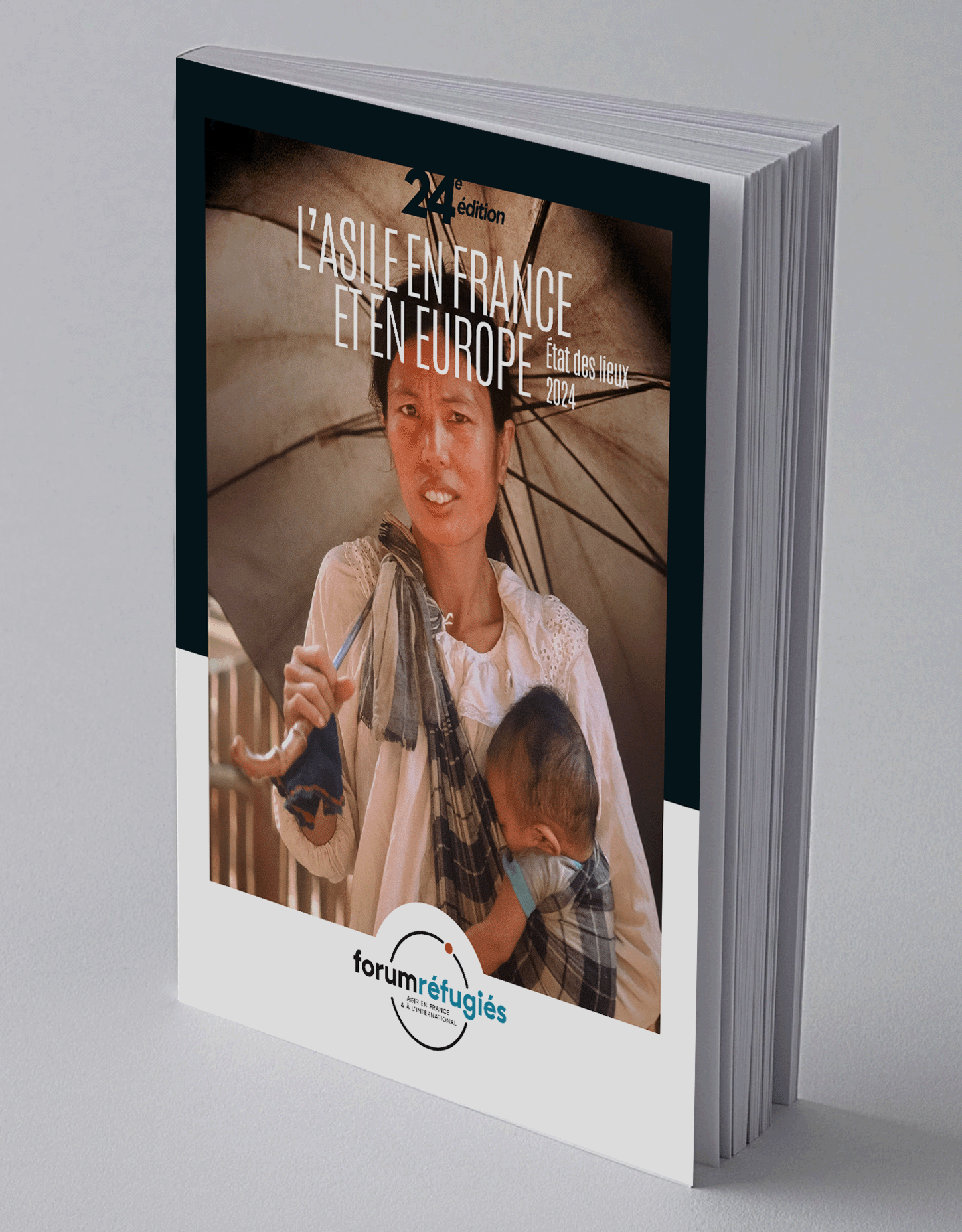Un an après l’adoption de la loi du 26 janvier 2024, quels changements dans la mise en œuvre du droit d’asile ?
Un an après l’adoption de la dernière loi réformant le système d’asile français en janvier 2024, la mise en œuvre des différentes dispositions demeure inégale. Les chambres territoriales de la CNDA sont mises en place et le nouveau contentieux sur les conditions d’accueil se développe, mais la phase pilote des nouveaux " pôles France asile " n’a pas encore été lancée.
La dernière modification du cadre juridique relatif à la mise en œuvre du droit d’asile a été apportée par la loi du 26 janvier 2024, dont plusieurs dispositions étaient d’application directe tandis que d’autres dépendaient de la publication de texte réglementaires. Le « Baromètre de l’application des lois », publié par l’Assemblée nationale, nous apprend qu’à la mi-février 2025, seules 16 des 30 mesures d’application (53%) de cette loi avaient été publiées.
Cette loi comporte plusieurs dispositions ayant un impact dans le domaine de l’asile (voir notre article de février 2024), dont la mise en œuvre plus d’un an après la promulgation demeure variable.
Concernant l’accès à la procédure d’asile, la mise en place de « pôles France asile » qui devait débuter par une phase pilote sur quelques territoires est pour l’instant en suspens. Les arrêtés qui doivent dans un premier temps fixer ces sites pilotes n’ont pas encore été publiés, mais les préfectures de Haute-Garonne, de Moselle et du Val d’Oise sont évoqués depuis plusieurs mois. Un décret du 16 juillet 2024 a déjà précisé les missions qui seront assurées par l’OFPRA dans ces pôles territoriaux en matière d’information des demandeurs et de recueil des éléments de la demande d’asile via un formulaire dématérialisé.
La loi du 26 janvier 2024 a également élargi les possibilités de placement en rétention des demandeurs d’asile, qui peuvent ainsi être amenés à mener leur procédure d’asile dans ces lieux de privation de liberté (en cas de menace à l’ordre public ou lorsque la demande a été exprimée auprès d’un autre interlocuteur que la préfecture). En métropole, cette possibilité a été utilisée moins d’une dizaine de fois en 2024, mais de nombreux demandeurs d’asile originaires de pays d’Afrique des grands lacs ont été enfermés sur cette base au centre de rétention de Mayotte, où leur demande a été instruite selon la procédure d’asile en rétention - assortie de moindre garanties procédurales.
La possibilité ouverte par la loi de prendre une mesure de clôture de la demande d’asile lorsque la personne abandonne son lieu d’hébergement ne semble pas trouver d’application pratique pour l’instant, tout comme l’élargissement de l’irrecevabilité pour les personnes déjà protégées dans un autre État (sur ce thème, nous manquons cependant d’informations sur les pratiques de l’OFPRA en Guyane, territoire pour lequel cette mesure avait a priori été pensée).
Sur la phase de recours, la loi a consacré une réforme majeure du fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile dont la mise en œuvre a débuté. La généralisation du juge unique est permise par un décret du 8 juillet 2024, qui porte également sur le déploiement des chambres territoriales. Désormais, la CNDA comprend 23 chambres regroupées en 6 sections, dont 4 chambres territoriales et 18 chambres au siège de la Cour, à Montreuil. Les chambres territoriales sont implantées à Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse, et leur activité a débuté en fin d’année 2024, tandis que les chambres territoriales de Nantes et Marseille seront établies en 2025. Les recours de personnes originaires de pays présentant une situation géopolitique complexe ou qui parlent une langue rare continueront d’être auditionnées à Montreuil.
Dans l’éditorial du rapport d’activité 2024 de la CNDA, le président de cette juridiction se veut rassurant quant à la généralisation du juge unique en indiquant qu’« au regard des questions qui se posent devant le juge de l’asile, le recours à une formation collégiale est resté majoritaire pour les affaires venues à l’audience ». Sur l’ensemble de l’année, on ne constate pas d’effet visible de cette disposition (cependant entrée en vigueur à la mi-année seulement), la part des audiences à juge unique sur l’ensemble des audiences passant de 22,6% en 2023 à 23,3% en 2024.
Dans le domaine des conditions matérielles d’accueil (CMA) pour demandeurs d’asile, la loi a instauré un recours contentieux spécifique pour contester les refus et cessation de CMA notifiés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce dispositif, applicable depuis la publication du décret du 5 juillet 2024, permet désormais aux demandeurs de disposer d’une voie de recours plus effective pour faire valoir leur situation individuelle auprès des tribunaux administratifs. Ces derniers ont par exemple suspendu les décision de l’OFII privant les demandeurs d’asile de CMA pour une femme enceinte isolée ne disposant d’aucune ressource ni hébergement pérenne ou encore pour une mère isolée avec trois jeunes enfants hébergée de façon précaire par un tiers. Malgré la volonté initiale du législateur de renforcer le caractère automatique des refus et cessation de CMA, la version finale de la loi du 26 janvier amendée à ce sujet précise bien que l’OFII doit apprécier situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté certaines obligations. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé cette nécessité d’un examen individuel, conformément à la directive européenne dite « Accueil », et ce nouveau contentieux pourrait contraindre l’OFII à y être plus attentif.
Alors que la loi du 26 janvier 2024 n’est donc pas encore pleinement appliquée, un nouveau cadre législatif va prochainement s’imposer en France : les différents textes du Pacte sur la migration et l’asile adopté à l’échelle européenne s’appliqueront au cours de l’été et leur déclinaison en droit national nécessitera une intervention du législateur pour modifier le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.